À partir du corpus CoCo établi par Ilan Manouach (monoskop.org/Conceptual_comics)
Speculoos, spéculum & bulle spéculative

Speculoos : n.m. Petit biscuit sec traditionnel (spécialité belge). Étym. Le nom actuel correspond à la prononciation brabançonne de speculaas, vraisemblablement dérivé du néerlandais ancien speculatie. En wallon liégeois, on parle de spéculåcions.
Speculum : n.m. Instrument permettant d’agrandir et de maintenir béantes certaines cavités afin de pouvoir mieux en examiner l’intérieur. Étym. Du latin speculum, miroir.
Bulle spéculative : phylactère extrait d’une bande dessinée spéculative.
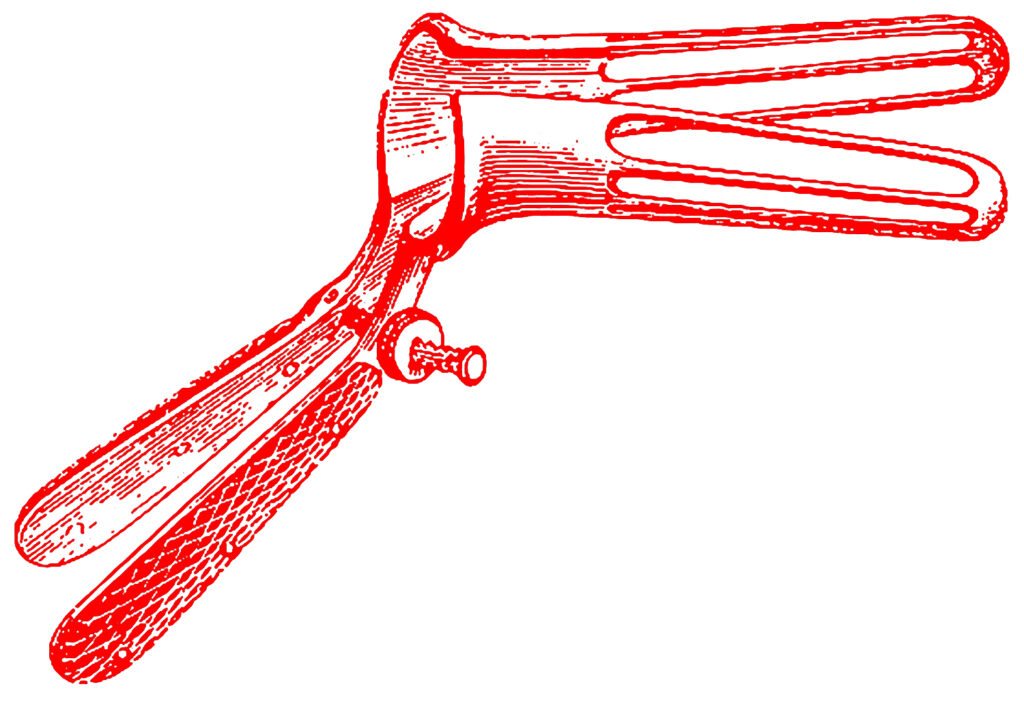
Les bandes dessinées spéculatives sont des œuvres qui interrogent leur propre discipline et les conditions de leur création, de leur production, de leur diffusion et de leur réception. Ces œuvres sont parfois ironiques et insolentes, parfois astucieuses et ingénieuses, parfois ludiques, voire potaches, parfois austères et rigoureuses, souvent radicales, toujours éloquentes et révélatrices.
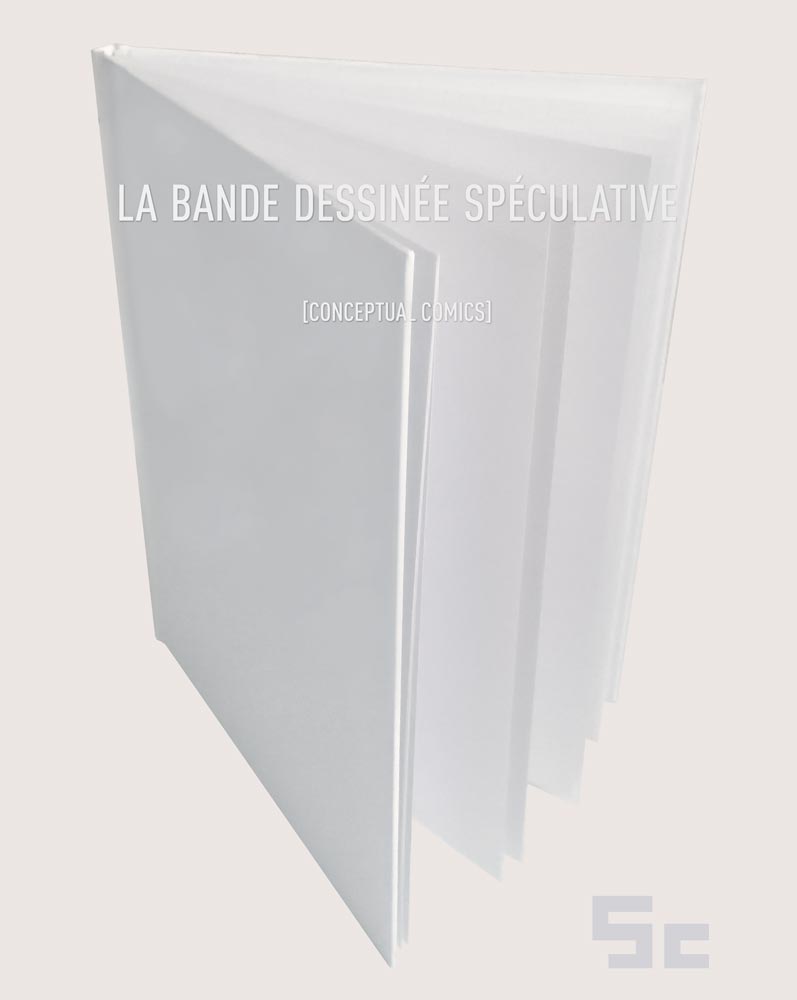
Affiche de l’exposition (Xavier Löwenthal)
Bande dessinée spéculative. On ne manquera pas de nous interpeller sur cette appellation. Le qualificatif spéculatif recouvre de vastes territoires et ce que nous voulons désigner est pratiquement indéfinissable. Si l’on part du principe que tout terme est impropre à désigner ce qu’il désigne, on nous accordera le droit de choisir un terme en usage dans l’analyse des œuvres (spéculatif), de le redéfinir et de le réactiver pour forger une expression de toute pièce : la bande dessinée spéculative. La locution bande dessinée elle-même est impropre : toutes les bandes dessinées ne sont pas en bandes, toutes les bandes dessinées ne sont pas dessinées, de même que tous les fumetti ne sont pas pourvus de phylactères, que tous les comics ne sont pas comiques et que tous les mangas ne sont pas constitués d’images malhabiles ou grotesques, si l’on s’en tient à la traduction littérale du terme.
Au départ, il y a le travail d’Ilan Manouach autour de ce qu’il appelle Conceptual comics, pour lequel il a forgé l’acronyme allant de soi : Coco (monoskop.org/Conceptual_comics). Il a quelque chose de plaisant, en ce qu’il évoque immanquablement, en français, le sobriquet donné aux communistes et que la matière qui nous occupe a justement trait à ce qui est commun, ou revendiqué comme tel, dans toute production culturelle. Nous rebondissons sur la proposition de Manouach, mais, comme vous l’aurez remarqué, nous ne traduisons pas son expression par bande dessinée conceptuelle. La raison en est expliquée dans une longue (non, interminable) note de bas de page.

Les œuvres de bande dessinée spéculative opèrent une action critique, un questionnement dans le champ de la bande dessinée, elles déconstruisent la discipline elle-même (sa forme, sa spécificité), elles mettent en jeu le statut de ses acteurs (auteur.es, lect.eur.ices, édit.eur.ices, diffuseurs, imprimeurs, passeurs et passeuses, institutions), elles rendent sensibles ses cadres de production et ses modes d’existence (support matériel, diffusion, valeur symbolique, rôle social, incidence politique, etc.) Ces objets en bande dessinée qui interrogent ou attestent de leurs conditions de production, de création, de diffusion, de réception (toutes choses relevant de la sociologie, de l’économie, du marché et du politique), ou même qui restent en-deçà ou vont au-delà, en interrogeant les notions-mêmes d’auteur (éventuellement aboli, soit dispersé, collectif ou commun, soit remplacé par un algorithme ou une méthode) et de lecteur (des livres qui ne sont pas nécessairement destinés à être lus, mais qui attestent de leur propre intention en tant qu’objet culturel par le seul fait d’exister en tant qu’objet, en tant que livres). Des livres qui procèdent de l’application plus ou moins stricte d’un programme et d’une intention et qui, par ce fait-même, bouleversent l’idée qu’on se faisait de ce qu’ils auraient dû être, qui questionnent et repoussent les limites de la création et de l’édition, mais également, par conséquent, celles de la réception et de la lecture. Cette interrogation sur sa propre discipline est une constante en art depuis l’antiquité et, en ce qui concerne la bande dessinée, présente dès son origine.
Nous allons nous en tenir à cette définition très générale, même si elle est insuffisante à nous faire reconnaître une bande dessinée spéculative. Car chaque bande dessinée spéculative définit ses propres règles et, incidemment, redéfinit la bande dessinée selon un dispositif singulier.
La bande dessinée spéculative constitue donc un ancrage dans le réel, lorsque la bande dessinée narrative convoque l’imaginaire et, quand elle convoque le réel, elle le fait dans une optique documentaire (comme dans le cas de l’autobiographie), didactique ou dramatique (fictionnelle). Ce réel, convoqué par la bande dessinée spéculative, c’est la matérialité de son support, la concrétude de ses formes tangibles (dessin, grille, couleur, texture, papier), mais c’est aussi, et surtout, le champ social et politique dans lequel se déploient les modes de production, de diffusion et de réception du livre, ce champ dans lequel se construisent les rapports entre auteurs, éditeurs, diffuseurs, passeurs de toutes sortes, lecteurs, commentateurs, etc. Il ne s’agit pas exclusivement de réflexion métalinguistique et de déconstruction : si ces productions n’ont pas pour objet la représentation (i.e. du réel) ou la fiction, leur sujet est pourtant la vie ou le monde eux-mêmes, leurs représentations et leurs modes de production, de diffusion, de réception ainsi que les implications culturelles, sociales, économiques et politiques de ces représentations et de ces modes. Elles n’ont donc pas uniquement pour sujet et pour objet le média lui-même, comme c’est le cas des productions modernistes dans le champ des arts plastiques ou dans une certaine littérature, mais elles étendent leur zone d’investigation dans la sphère sociale et politique.

La bande dessinée spéculative n’est pas un courant ou un mouvement structuré, encore moins une famille, c’est une multitude de singularités, dont nous captons ici quelques manifestations. Il ne s’agit donc pas d’une tentative ou d’une stratégie de légitimation d’un groupe d’artistes, à la manière de ce qu’on a appelé, dans la première moitié du XXème siècle, «les avant-gardes ²» (Dada, cubisme, futurisme, surréalisme, suprématisme…). Du reste, personne ne s’est jamais revendiqué de la «bande dessinée spéculative». Nous venons de forger l’expression, par défaut.
Spéculer, selon le Dictionnaire historique de la langue française, est un emprunt savant (1345) au latin speculari, observer, guetter, espionner, dérivé de specula, lieu d’observation, hauteur, qui dérive lui-même de specere, regarder (qui a donné «spectacle»). Il concerne d’abord l’astronomie et l’astrologie : observer les astres. Il est plus tard devenu synonyme de «calculer», dans son acception familière et contemporaine : «spéculer quelque chose ou quelqu’un» («calculer quelqu’un ou quelque chose», comme dans l’expression «je l’ai pas calculé»). Vers 1350, il prend la signification de «considérer philosophiquement, en esprit, méditer», «créer des théories», en opposition à «mettre en pratique». À la fin du XVIIIe siècle, il prend le sens de «réfléchir» puis «faire des opérations financières ou commerciales» d’où, vers 1835, «compter sur quelque chose pour réussir un projet, obtenir un profit». Généralement, en philosophie, spéculatif est synonyme de théorique : qui s’oppose à la pratique. Spéculation, recherche abstraite, devient, par péjoration, «construction arbitraire de l’esprit». On voit que le choix du terme est pour nous arbitraire : les œuvres que nous rassemblons sous ce vocable n’ont rien de théoriques. Que serait d’ailleurs une «œuvre théorique», sinon un oxymore ? Dans ce corpus d’œuvre, deux dimensions de cette définition se manifestent :
La bande dessinée spéculative peut prêter à sourire, dès lors qu’elle amène des propositions qui déplacent le cadre habituel de nos conceptions de la bande dessinée. Ces propositions, ces coups de force, peuvent paraître dérisoires, incongrus, voire provocateurs. Ils peuvent prendre la forme d’une boutade, d’une potacherie intellectuelle, d’une cogitation masturbatoire. Nous invitons le lecteur à identifier la part critique qui est à l’œuvre dans ces propositions, au-delà de l’effet de surprise, au-delà de la tentation de les railler, au-delà de l’aspect strictement ludique ou gadget de certains procédés ou dispositifs. Posons-nous les bonnes questions : de quoi sont constitués cette part critique, cette position critique, ce geste critique ? de quoi sont-ils critiques ? Ils sont critiques le plus souvent des modèles généralement en usage. Le geste artistique disruptif révèle ces usages par le seul fait qu’il déroge aux règles en vigueur. En déplaçant le regard, il les fait éclater en tant qu’usage, en tant que convention ; des conventions que l’on voit désormais pour ce qu’elles sont (conventionnelles), qu’on croyait «naturelles» par simple habitude. Mais, évidemment, le lecteur reste libre de demeurer sur le seuil.
Ces œuvres rient aussi, elles rient avec nous, elles rient de leur propre situation en porte-à-faux et elles rient, ironiquement ou de façon jubilatoire, à travers leur action critique.
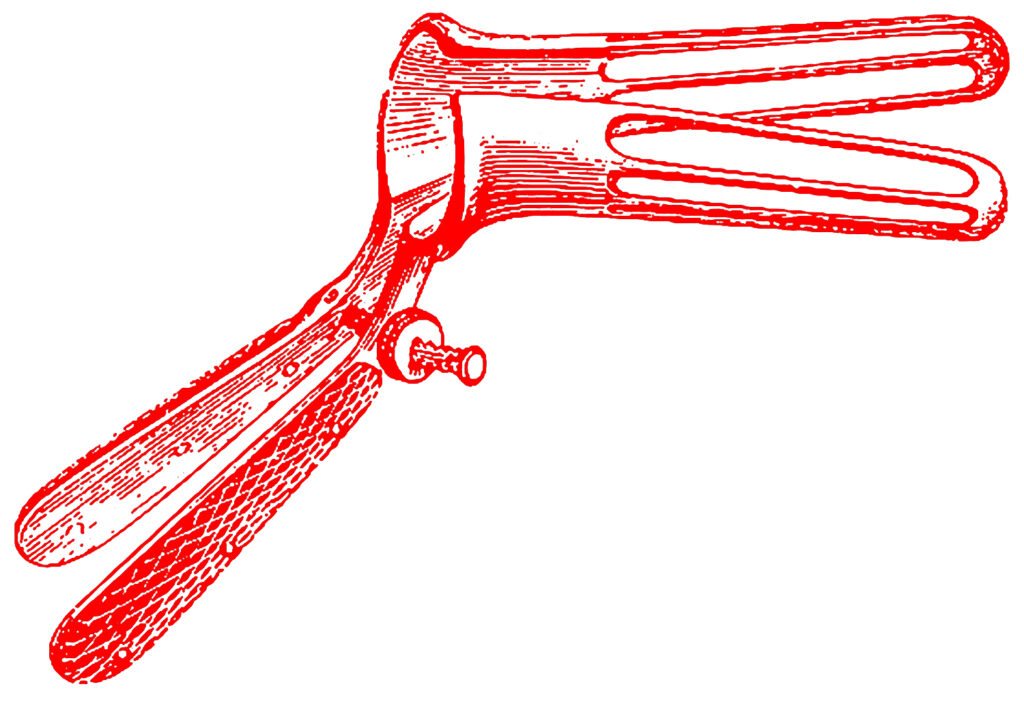
La bande dessinée spéculative n’est pas une forme aboutie ou supérieure de la bande dessinée, inscrite dans quelque illusoire progrès historique et esthétique. La bande dessinée spéculative ne se positionne pas comme un idéal artistique culminant ou transcendant, mais comme une modalité de la pratique en bande dessinée. La bande dessinée spéculative ne s’oppose pas à la bande dessinée artisanale, à la bande dessinée narrative ou à une bande dessinée essentiellement plastique (ou rétinienne, qui serait une bande dessinée axée essentiellement sur les qualités plastiques constitutives de l’image : matière, couleur, forme…). Tout simplement parce qu’une bande dessinée spéculative peut aussi prendre la narration ou la picturalité, par exemple, comme levier critique ou créatif.
Il y a un nombre considérable d’œuvres qui sont aptes à proposer des espaces récursifs, des retours sur eux-mêmes, qui posent un regard (critique) sur leur propre champ disciplinaire et leur champ éditorial (politique, social…), qui tournent autour de ces questions de façon plus ou moins explicite, plus ou moins tangible, plus ou moins saisissable, plus ou moins intelligible. Il y a du méta, du substrat, de l’infra chez bon nombre d’auteurs. Pour réduire le champ d’investigation, nous nous en tiendrons à toute bande dessinée qui pose un questionnement dans une forme d’assertion radicale. Par ailleurs, le choix des œuvres rassemblées ici demeure subjectif. Ce corpus a comme principale ambition de mettre à jour toute une tendance de la bande dessinée contemporaine qui demeure à ce jour peu visible.

Toutes une série de livres spéculatifs reposent sur le principe du détournement. Une grande partie des œuvres rassemblées dans ce corpus atteste du caractère collectif de la création. Toute œuvre étant collective et patrimoniale, dès sa conception, elle enrichit un corpus commun dans lequel on peut puiser, elle devient matériau pour des œuvres ultérieures. Il s’agit parfois de raviver le sens qui s’émousse ou s’altère : toute œuvre est (aussi) le produit de contextes ou est contingentée par des contextes, tant lors de sa création que lors de sa production, de sa diffusion ou de sa réception. Ces contextes, inexorablement, disparaissent, et il ne reste que l’œuvre, rendue parfois incompréhensible sans un exercice de réappropriation ou de réinterprétation. Comme on interprète une œuvre de répertoire, au théâtre ou en musique, on peut interpréter une œuvre plastique ou littéraire. Toute production culturelle nourrit le corpus dans lequel l’artiste peut légitimement puiser à sa guise, étant entendu que même l’œuvre la plus singulière de l’artiste le plus singulier est constituée d’éléments qui lui préexistent, d’éléments communs, et qu’elle est elle-même une production collective, un produit commun (comme l’écrivain le plus «génial» ne peut «inventer» sa langue ou son langage qu’à partir de la langue commune, qui le précède).
À ce caractère commun s’oppose, historiquement, la notion de propriété intellectuelle et les lois sur le droit d’auteur, censés garantir une «juste» rémunération pour les créateurs. Outre leur caractère éminemment problématique depuis l’avènement d’Internet (les plateformes de diffusion payantes, Deezer, Spotify, Netflix ou même YouTube, procurent surtout un sentiment de bonne conscience à l’usager, mais ne rémunèrent pas vraiment les artistes) et le fait qu’elles protègent davantage le brevet industriel que l’artiste ou le chercheur (qu’il s’agisse de code informatique, de produits pharmaceutiques ou d’œuvres d’art), elles constituent un frein à la création et à sa diffusion, dénoncé de longue date. Dans le respect strict des lois et des règles sur la propriété intellectuelle, même en profitant au maximum de leurs exceptions expressément prévues (droit de citation, de parodie, de copie privée…), il n’y aurait ni jazz, ni rock et moins encore de rap. Le moyen de rémunérer justement les artistes et les créateurs est encore à inventer. À cet égard, les opérateurs industriels de diffusion (sociétés de communication, propriétaires de plateformes, etc.) ne manquent certainement pas de ressources et chaque usager s’acquitte mensuellement de frais d’abonnement coûteux, à leur seul profit. La production des contenus est parfois financée. Les artistes, rarement. Si ces derniers produisaient dans le strict respect de ces règles absurdes, et en proportion de leur «juste» rémunération, Internet serait vide, les radios, muettes, les livres, blancs. Les artistes s’arrogent donc, à juste titre, ce droit de piraterie et chacun peut prendre son pied (c’est-à-dire sa part du butin, déposée au pied de chaque boucanier, pour en jouir librement).
Certaines publications spéculatives versent dans une forme d’illisibilité : là où certains détournements (comme Riki fermier ou Katz d’Ilan Manouach) proposent des relectures des œuvres détournées, donc des lectures tout de même, des objets comme Blanco, le ready-made d’Astroboy ou le code postscript du pdf de The Dark Knight returns sont la matérialisation de leur principe et, en tant que tels, n’ont pas forcément vocation à être lus. Affirmer que la lecturabilité d’une bande dessinée puisse être accessoire à son existence en tant que bande dessinée peut s’avérer insupportable, tant, pour les détracteurs de la bande dessinée spéculative, la lecturabilité constitue un élément irréductible à la définition d’une bande dessinée digne de soi.
Ces détournements illisibles deviennent donc des objets, sans matière à lire. L’Art conceptuel des années soixante a émis l’hypothèse qu’une œuvre conceptuelle pouvait être réduite à son énonciation, à sa description, sans forcément trouver d’issue concrète dans un objet d’art matérialisé (Joseph Kosuth, Isidore Isou, Sol Lewitt, Art & Language…). Dans certains exemples décrits ci-après (Blanco, Astroboy tome 6, The Dark Knight returns…), c’est l’inverse : c’est précisément la concrétisation de l’idée, sous la forme d’un livre imprimé et diffusé, qui fait sens, parce que ces objets font le procès de leur propre nature d’objets culturels manufacturés.
La bande dessinée a vocation à être lue sur un support imprimé. C’est un art industriel. L’auteur pense son œuvre, conçoit son objet pour qu’il soit publié dans un livre et lu par un lecteur à travers ce support (il faudrait trouver un autre terme que le mot lire pour désigner le processus consistant à déchiffrer une bande dessinée, tant cette opération implique des opérateurs complexes qui dépassent la simple analogie à ce qui s’opère lors du déchiffrement d’un texte. Certains forgent le néologisme liregarder). Dans le cas d’une bande dessinée spéculative, qui va, à plus forte raison, réfléchir sur la forme-même de la bande dessinée, à savoir un livre imprimé, diffusé et « consommé », cette forme matérielle est déterminante. C’est pourquoi l’exposition est constituée exclusivement des œuvres telles qu’elles ont été publiées : sous leur forme originelle de livre, revue, fanzine, etc. Chaque œuvre est accompagnée d’un panneau qui explicite le rattachement de celle-ci dans le corpus de la bande dessinée spéculative.
Concrètement, les publications sont présentées plus ou moins à l’horizontal pour évoquer l’expérience idéelle de lecture (idéelle, parce que les expériences de lecture de la bande dessinée sont diverses, la position du livre et de son lecteur est éminemment protéiforme (ne fut-ce quand on lit au lit). Mais l’idée de ne pas accrocher ces œuvres verticalement consiste à trancher radicalement avec la présentation verticale traditionnellement en vigueur dans les autres arts plastiques, en particulier la peinture, et, sur laquelle la présentation de la bande dessinée, dans sa forme muséale, ou en galerie, s’est jusqu’ici alignée).
Dans cette logique très matérielle, la présentation de ces livres s’accompagne de la vente de ces livres (pour ceux qui ne sont pas épuisés évidemment). Une des dimensions critiques de la bande dessinée spéculative consiste à mettre l’accent sur le fait qu’un livre est une marchandise qui s’inscrit dans des circuits de diffusion commerciaux bien établis. Le Shop fait donc partie intégrante de l’exposition.
Le site de l’exposition excède de beaucoup l’étendue des œuvres présentées, son corpus est voué à s’étendre bien au-delà des 40 œuvres sélectionnées pour l’exposition.
Les livres présentés sont signés :
Rosaire Appel, les Sœurs Bernadette, Blow Book, Laurent Bruel, Sezgin Boynik, Guillaume Chailleux, L.L. de Mars, Jessy Deshais, Nikita Fossoul, Corentin Garrido, Jochen Gerner, Dominique Goblet, William Henne, François Henninger, Bernard Joubert, Loïc Largier, Olivier Lebrun, Jean Leclercq, Emmanuel Leglatin, Jérôme Leglatin, Xavier Löwenthal, Ilan Manouach, Pascal Matthey, Richard McGuire, Jérôme Mulot, Jérôme Puigros-Puigener, Françoise Rojare, Florent Rupert, Samplerman, Greg Shaw, Robert Sikoryak, David Vandermeulen, Robert Varlez, Yûichi Yokoyama.
Le catalogue est téléchargeable ICI.
L’exposition s’est déroulée du 11 au 21 mars 2024 à LUCA School of Arts à Bruxelles.
Coordination : William Henne
Design : Nonpareil
Graphisme : Xavier Löwenthal
English proofreading: Simon Blackley

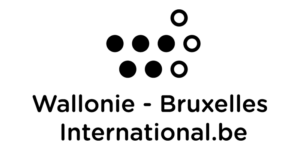
Note 1 : Pourquoi ne pas traduire littéralement conceptual par conceptuel ? En vérité, ce n’est pas la référence au concept en philosophie qui serait gênante, mais la référence inévitable à ce courant artistique né dans les années soixante : l’Art conceptuel. Une des définitions les plus courantes de l’Art conceptuel a été formulée par Joseph Kosuth : Art as Idea as Idea, un art à l’os, dégagé de l’artisanat, de la facture, du style, voire, parfois, de la mise en œuvre de l’objet artistique concrétisé matériellement. Ce mouvement aurait pu s’appeler art épistémique, art heuristique, art noétique, art idéel, art déconstructionniste ou même art réflexif, ou tout simplement art analytique, mais ils ont choisi de l’appeler Art conceptuel. Ils ont donc forgé cette expression et construit leur mouvement autour de ce terme choisi, non pas de façon arbitraire, mais de façon conventionnelle, parmi d’autres possibles. Ils auraient d’ailleurs pu utiliser, à la manière de Dada, un mot totalement arbitraire. Il est donc historiquement connoté. Si l’on reprenait le même terme, il inscrirait les travaux en bande dessinée ainsi nommés dans cette généalogie et les subordonnerait à cette antériorité muséale. C’est là l’écueil : vassaliser encore la bande dessinée à un suzerain issu des arts «légitimes» (comme si on inventait demain la bande dessinée impressionniste (ou Dada) pour se dépatouiller ensuite de cette embarrassante filiation). Aucune pratique n’a besoin de caution d’aucune sorte, de se légitimer, surtout pas par quelque adoubement de plus noble qu’elle (même si la bande dessinée en a eu longtemps la tentation : elle a trop souvent voulu assimiler des éléments issus de la littérature, du cinéma et des autres arts plastiques, pour être reconnue, s’éloignant même de ses propres spécificités).
L’autre problème réside dans le fait qu’en art contemporain, le mot conceptuel est devenu, après la période révolue de l’Art conceptuel, une étiquette paresseuse pour désigner tout ce qui n’est pas rétinien (et encore plus ce qui n’est pas narratif, mais l’art moderne avait déjà évacué la narration, l’anecdotique), en oubliant que ce vocable est ancré historiquement et avait été choisi, dans les années soixante pour réunir une poignée d’artistes dans un mouvement qui connut encore quelques effets dans les années septante. Si ce mouvement avait choisi un autre vocable, comme analytique pour prendre un exemple cité plus haut, c’est lui qui aurait pris le sens usuel de non-rétinien. Le sens vernaculaire que le mot conceptuel a pris après les années septante (un art non-rétinien et non-narratif) a perdu toute pertinence dans la sphère culturelle actuelle. Il ne renvoie plus à rien, dès lors que l’Art conceptuel a existé dans un temps déterminé (faire de l’art conceptuel après les années septante consisterait à reproduire des démarches à la manière d’un néo-impressionniste ou d’un peintre du dimanche) et que le mot conceptuel, dans son acception philosophique, ne recouvre en rien cette notion de non-rétinien ou de non-narratif. La notion de concept est tellement connotée, tellement chargée historiquement, dans le champ artistique, qu’on ne peut pas l’employer sans malentendus.
Notion discutée et disputée depuis des siècles, en philosophie, la notion de concept désigne l’idée, la représentation de l’esprit. Selon le Dictionnaire historique de la langue française : concept est emprunté (1404) au latin conceptus, «action de contenir», participe passé substantivé de concipere, concevoir. Son acception philosophique date de 1606 (Descartes) et le «concept de concept» nous vient de Kant, qui en fait un schéma dynamique et non une configuration statique. Pour le philosophe Gilles Deleuze, « la philosophie est l’art de former, d’inventer, de fabriquer des concepts » (Qu’est-ce que la philosophie ?), ce dont il ne s’est jamais privé. «Un concept, ce n’est pas du tout quelque chose de donné. … Je dirais que le concept, c’est un système de singularités prélevé sur un flux de pensée». S’ajoute à cela un usage vernaculaire et malencontreux du mot dans le monde de la publicité et du design. Si l’on voulait se référer à la notion de concept en philosophie, on pourrait dire que toute œuvre, et donc toute bande dessinée, est conceptuelle, puisqu’elle colporte en elle-même des idées, qu’elle contient son langage, son dispositif, son principe créatif et ses significations. Da Vinci parlait, bien avant l’avènement de l’Art conceptuel, de cosa mentale, pour parler de peinture. Pour faire simple, si on entend la notion de concept au sens philosophique, il est évident qu’il y a plus de concepts dans La descente du croix de Rubens (1614) que dans la proposition tautologique de Kosuth, One and Three Chairs (1965), où l’artiste américain a procédé à la réduction cognitive d’une chaise, déclinée sous forme d’objet, de photo et de définition (trois différents processus de connaissance d’une même chose), lorsque le tableau de Rubens charrie une infinité de concepts picturaux, philosophiques, théologiques, historiques, etc. Au sens philosophique, Rubens est plus conceptuel que Kosuth.
Dès lors que, dans la sphère artistique, le mot conceptuel ne peut plus se référer à la philosophie, il ne peut que renvoyer à la brève période historique de l’Art conceptuel. Pour mieux comprendre la perte de sens que le mot conceptuel a subi, il n’y a qu’à songer au mot surréaliste, qui n’a plus rien à voir avec ce que Breton ou Nougé avaient conçu. Si un mouvement de bande dessinée surréaliste surgissait aujourd’hui, il serait fatalement perçu comme une référence au surréalisme des années 20 ou à ses dérives affadies (à savoir : une allégeance à ce mouvement et un enfermement dans ce moment historique) et pas au sens courant et banal qu’a pris ce terme aujourd’hui («absurde», «inouï», « insolite », etc.)
Les artistes de toutes les pratiques dialoguent avec ce qui les ont précédés et s’en font les critiques ou les citateurs. Tirer sa force de cadres institués, de forces existantes (les disciplines adoubées), cela déforce la discipline elle-même. S’en référer à des disciplines estimées pour légitimer sa propre pratique relève d’un complexe d’infériorité et de l’intériorisation du mépris qu’on subit, alors que la légitimation de la bande dessinée n’a fondamentalement pas d’importance en soi, les jugements condescendants à son égard sont la plupart du temps le fait de l’ignorance de ses détracteurs. Les arts dits mineurs ont d’ailleurs su tirer parti de la liberté que la marge confère. Une subordination à ce mouvement historique bien circonscrit dans le temps, l’Art conceptuel, procèderait de la même tentative pathétique de légitimation de la bande dessinée quand elle invente la notion de roman graphique pour emboîter le pas à la littérature ou quand elle s’approprie les oripeaux des arts légitimés, comme la picturalité ou le matiérisme. Pour citer Ilan Manouach dans la thèse qu’il défendit à l’Aalto University en Finlande : “[…] painterly experimentation in comics was in retrospect a class statement. It seemed to be an opportunity for its practitioners to elm-evate comics craft in the cultural sector by addressing collectors and gallerists rather than readers and publishers” (“L’expérimentation picturale dans la bande dessinée était rétrospectivement une affirmation de classe. Elle semblait être l’occasion pour ses praticiens de faire évoluer l’artisanat de la bande dessinée dans le secteur culturel en s’adressant aux collectionneurs et aux galeristes plutôt qu’aux lecteurs et aux éditeurs” in Estranging Comics. Towards a novel comics praxeology, Aalto University, 2022).
Car il serait dommage d’instituer une filiation de la bande dessinée spéculative à une période de l’art révolue, d’autant plus que nous souhaitons réunir, sous cette expression arbitraire, des œuvres qui opèrent dans le champ distinctif de la bande dessinée et travaillent sur ses propriétés tant internes (ses formes, ses figures…) qu’externes (son histoire, sa production, sa diffusion, sa réception…). Et, effectivement, le corpus qui est présenté dans l’exposition n’a pas grand-chose à voir avec les propositions artistiques et les procédés mis en place par l’Art conceptuel, tant ce corpus déploie une approche spécifique à sa discipline.
Note 2 : la notion, militaire, d’avant-garde, rabattue sur l’art, est une idée qui a prospéré au XXème siècle au sein de collectifs d’artistes qui devaient s’affirmer, se distinguer et faire rupture, quitte à oblitérer les traditions artistiques qui les précédaient (ou à «brûler les musées»). Les tenants des avant-gardes successives du XXème siècle étaient tantôt dupes de leur propre discours, portés par un idéal révolutionnaire, tantôt clairvoyants sur ce qui se jouait : à savoir que ce positionnement disruptif n’était jamais que politique, autrement dit, c’était une prise de position stratégique, de l’intimidation intellectuelle réfléchie. En gros, si on joue la carte de la table rase, on évacue la tradition et on manifeste sa nouveauté radicale, à la manière d’une génération spontanée. Ou alors ces mouvements créaient leur propre légende (aujourd’hui on dirait story telling), se créant parfois une antériorité flatteuse, en cooptant, ou en usurpant, des œuvres passées qui ne lui ont rien demandé (ce fut le cas du Surréalisme). Un des principaux promoteurs de l’Art conceptuel dans les années soixante, Joseph Kosuth, dans sa définition de l’Art conceptuel, fait remonter celui-ci à Duchamp, au début du XXème siècle (“Tout art (après Duchamp) est conceptuel de nature parce que l’art n’a plus d’existence que conceptuelle” in Teksten/textes, page 102 ICC, Bruges, 1976). Si l’Art conceptuel est effectivement redevable au ready-made de Duchamp, le geste de Duchamp précède de quarante ans l’Art conceptuel. Poser une étiquette forgée de toute pièce quarante ans plus tard sur une œuvre antérieure est au pire un anachronisme, au mieux une appropriation frauduleuse («au mieux», car l’appropriation fait partie intégrante des moyens de l’artiste spéculatif).